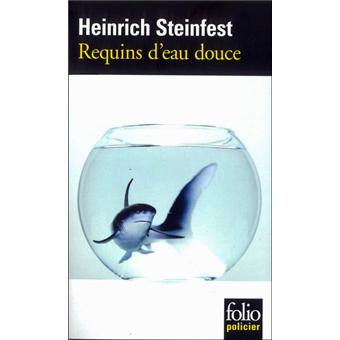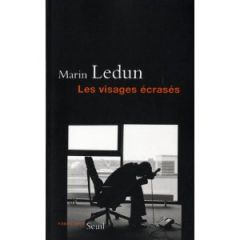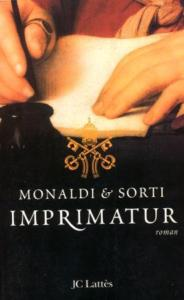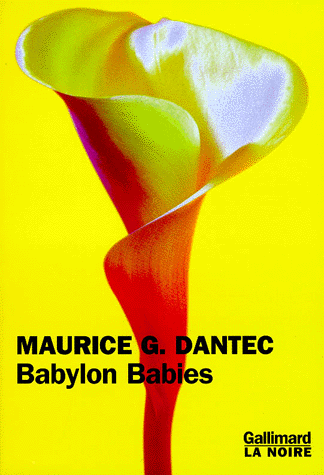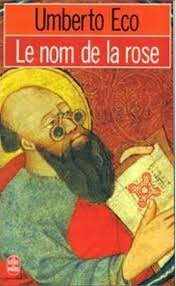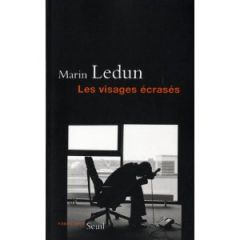 Dans l’immense galaxie du polar, l’œil averti distingue les romans à énigme, les romans coup-de-poing, les romans historiques et les romans à suspense. Avec « Les visages écrasés », Marin Ledun inaugure un polar d’un genre nouveau : le thriller étouffoir, qui vous saisit à la gorge et ne vous lâche plus jusqu’à la dernière page. On le recommande vivement à un très large public, sauf aux quelques-uns qui souffrent de harcèlement au travail. A ceux-là, réitérons l’avertissement de Dante : « Toi qui entres ici, abandonne toute espérance. »
Dans l’immense galaxie du polar, l’œil averti distingue les romans à énigme, les romans coup-de-poing, les romans historiques et les romans à suspense. Avec « Les visages écrasés », Marin Ledun inaugure un polar d’un genre nouveau : le thriller étouffoir, qui vous saisit à la gorge et ne vous lâche plus jusqu’à la dernière page. On le recommande vivement à un très large public, sauf aux quelques-uns qui souffrent de harcèlement au travail. A ceux-là, réitérons l’avertissement de Dante : « Toi qui entres ici, abandonne toute espérance. »
L’action se situe dans un centre d’appels de la banlieue de Valence, dans la Drôme. Une de ces plateformes de réception téléphonique comme il en existe des milliers en France – une suite d’alvéoles où les téléopérateurs réceptionnent à longueur de journée les appels de clients mécontents et en profitent pour tenter de leur vendre de nouveaux abonnements.
Nous nous retrouvons en présence de l’un d’eux, ou du moins de ce qu’il en reste : Vincent Fournier, la petite cinquantaine, ancien cadre supérieur dans les télécoms rétrogradé au rang de téléconseiller suite à une restructuration. Travail répétitif, cadence infernale, salaire misérable, brimades de ses supérieurs hiérarchiques. Horizon professionnel réduit à néant. Psychisme pulvérisé. Dépression chronique. Une tentative de suicide. Une tentative de meurtre sur la personne de sa superviseuse.
Face à lui, le docteur Carole Matthieu, médecin du travail rattachée à cette entreprise. Elle suit Vincent Fournier depuis plusieurs années. Elle sait qu’il ne s’en sortira pas. Que sa vie s’est écroulée, morceau par morceau. Et que le reste de sa vie sera plus qu’une longue souffrance. Pour le docteur Matthieu, il n’y a qu’une seule solution : une injection de tranquillisant suivie d’une balle de Beretta 92 en pleine tête. Pas un meurtre : un acte médical. Un pur élan de compassion. Ce geste de miséricorde enfin posé, la médecin du travail peut rentrer chez elle pour une nouvelle nuit d’insomnie.
Carole Matthieu sait qu’elle n’échappera pas à la police. Que tôt ou tard l’enquête remontera jusqu’à elle. Mais elle veut tenir encore quelques jours, le temps de terminer son travail. Elle veut raconter l’autre Histoire. Non pas l’histoire officielle, qui déplorera la mort tragique d’un employé en proie à des problèmes personnels. Ce qui l’intéresse, c’est de faire éclater au grand jour l’horreur que lui inspire un système basé sur l’exploitation outrancière de l’individu et la négation de toute dignité humaine. Vincent Fournier n’est pas un cas isolé : il représente l’aboutissement d’une logique de destruction de l’individu par l’entreprise.
Pendant qu’elle reconstitue ses dossiers en secret, une incommensurable souffrance vient échouer par vagues successives dans son cabinet. La médecin du travail les voit tous défiler, ceux pour qui elle se bat depuis des années. Le téléconseiller Hervé Sartis, deux tentatives de suicide. Christine Pastres, la superviseuse détestée de Vincent Fournier, sous anxiolytiques. Le vigile Patrick Soulier, choc post-traumatique suite à trois agressions en six mois, dépressif et alcoolique. Salima Yacoubi, la femme de ménage du site, harcèlement moral et tentative de viol. Le docteur Carole Matthieu tient le coup comme elle peut, entre amphétamines et antidépresseurs. Elle s’est juré d’aller au bout de sa mission, dénoncer la logique du chiffre et de l’humiliation. Elle n’hésite pas à affronter le directeur du site, Vuillemenot. Un directeur général pas pire qu’un autre, pourtant. Ce n’est pas qu’il soit indifférent au malheur qui a frappé Vincent Fournier : il n’y a pas de place dans son agenda pour une minute d’affliction. Quant aux syndicalistes de la boîte, ils se réfugient derrière leur mandat pour mieux protester en silence. Tous complices. Tous emportés par ce vaste processus de fabrication de valeur ajoutée, un œil sur le chronomètre et un autre sur l’emprunt immobilier à rembourser.
Carole Matthieu a les preuves. Les rapports de consultation. Les ordonnances. Les préconisations thérapeutiques, jamais suivies d’effets. Elle va tout dévoiler. Les suicides ne sont pas le fait de pauvres types confrontés à des problèmes personnels, comme l’insinue la direction. Non, les suicides constituent l’aboutissement logique d’un système qui fait passer l’impératif de rentabilité à court terme avant toute autre considération. Elle n’a besoin que de quelques jours pour reconstituer l’écheveau des conflits, souffrances et agressions qui ont émaillé la vie de l’entreprise ces dernières années et provoqué le dépérissement de dizaines d’employés. Encore faut-il que la police, en particulier le dangereusement séduisant lieutenant Richard Revel, lui en laisse le temps. La course poursuite est engagée. Valse au bord de l’abîme.
On ne rigole pas avec Marin Ledun, et la question est posée sans précaution oratoire : la vie a-t-elle encore la moindre signification lorsqu’elle se résume à un travail dépourvu de toute forme de reconnaissance ? En filigrane, « Les visages écrasés » constitue un impitoyable réquisitoire contre un système économique qui a élevé le productivisme au rang d’impératif catégorique. Un système barbare – car c’est bien aux effets d’une nouvelle barbarie que nous assistons. Comme toutes les barbaries, le capitalisme se pare d’atours scientifiques afin de légitimer sa toute-puissance. C’est le règne de l’objectif. Objectif du téléopérateur : vendre un maximum d’abonnements, trois minutes par communication, pas une seconde de plus. Objectif du superviseur : maintenir un niveau élevé de performance, quitte à sermonner, fliquer et humilier ses subordonnés. Objectif du top management : faire tourner le centre d’appels, générer un maximum de profits. Objectif de la maison-mère, tout là-haut dans les limbes : dégager la plus grande marge bénéficiaire possible pour les actionnaires.
A la base, l’employé n’est rien. Un maillon d’une chaîne de production, insatisfaisant par définition et jetable à volonté. Pour s’en débarrasser, rien de plus simple : il suffit de relever le niveau de ses objectifs, de le muter dans un autre service sans aucune explication, de lui assigner de nouvelles tâches à intervalles de plus en plus rapprochés. Tout être humain normalement constitué ne peut résister à un déracinement aussi systématique. En perdant ses repères, il est condamné à l’implosion. A travers le personnage de la médecin du travail, Marin Ledun démonte avec sang-froid la mécanique de la violence au travail : une violence diffuse faite de politesse glacée, de consignes débilitantes envoyées par mail et de recommandations tatillonnes et aliénantes. On n’interdit pas, on incite fortement. On ne punit pas, on fait un point. On ne vire pas, on procède à un plan de sauvegarde de l’emploi. Langage scientifique et déshumanisé qui dissimule une réalité autrement plus tragique : la destruction de l’homme sur l’autel de la rentabilité immédiate. Tel Charlot dans son usine, le télévendeur doit s’adapter à la consigne : trois minutes par communication, et surtout garder le sourire. De cette somme d’injonctions contradictoires – soyez humain à distance – se dégage une souffrance indicible. Le pire, c’est que l’employé ne peut s’en prendre qu’à lui-même : il a signé un contrat, il a donné son accord. Victime consentante, il n’a d’autre choix que de se dissoudre dans la structure de l’entreprise pour la bonne raison qu’il ne trouve plus en lui la force de se révolter. Dans un passage remarquable de lucidité, Marin Ledun dresse le constat de cette défaite : « La souffrance naît de la disparition progressive de tous ces minuscules espaces de liberté nécessaires et vitaux sur lesquels le top management rogne pour accroître les marges de productivité : la minute de pause en moins, les réponses à formuler au client chronométrées à la seconde – pas une de plus –, la pause cigarette réduite de moitié, le téléphone directement branché sur celui du supérieur, le script standardisé au mot près à servir à chaque client ou le sourire programmé. » L’employé n’a d’autre échappatoire que de retourner sa violence contre lui-même. Stress, alcoolisme, dépression, burn out, suicide. Simple question de temps. Usure progressive, rien de plus.
Il n’est pas anodin que l’action prenne place dans une plateforme de réception d’appels – et c’est l’une des nombreuses lignes de force de ce roman au lyrisme de banquise. Symbole de l’atomisation de la société, perversion ultime d’une technologie qui réduit la communication à une simple procédure, la plateforme d’appels éclaire d’une lumière crue la condition de l’homme moderne : prisonnier d’une alvéole, coupé de ses semblables, le téléconseiller répète à longueur de journée un discours pseudo empathique dans le seul but de vendre un soi-disant service, le tout sous la surveillance d’un superviseur chargé de maintenir son rendement à un taux élevé – en fait, de l’épuiser à la tâche. Des passerelles pourraient être jetées entre les interlocuteurs, de l’humanité pourrait naître de ces échanges. L’impératif des trois minutes – et pas une seconde de plus – balaie ces possibles pour rédimer le télévendeur à un chiffre, son indice de rentabilité. Enfermé dans sa consigne, le travailleur doit s’évertuer à atteindre l’épanouissement professionnel, donc personnel. Le centre d’appels comme épitomé de la civilisation occidentale.
Au bout du compte, la question essentielle que pose « Les visages écrasés » est celui du sens de la valeur travail : dégager de la plus-value pour une entreprise suffit-il à justifier une existence ? L’homme n’existe-t-il qu’en terme d’employabilité ? Les personnages de Marin Ledun répondent comme ils le peuvent à cette question, tels des rats pédalant dans la roue d’une cage, logiques et obstinés. C’est bien ce qui les rend si effrayants et, hélas, si familiers. De voir cette horreur si cliniquement exposée, on est saisi de vertige : et si c’était moi ? Et si moi aussi, je participais de cet immense jeu de dupes, de cette entreprise globale qui ne vise qu’à pressurer les individus comme des citrons pour en extraire jusqu’à l’ultime goutte de force vive ? Et si de moi ne subsistait en définitive qu’un lambeau de peau séchée ?
La question renvoie de façon inexorable aux thématiques totalitaires, si magistralement formulées par Hannah Arendt. Comme dans le communisme stalinien ou le nazisme, l’individu capitaliste se résume à une seule dimension, sa dimension utilitaire. Il n’est qu’un élément parmi d’autres, inséré dans un système qui le dépasse infiniment – l’empire de la création de richesse – et le justifie. Car comme dans le communisme ou le nazisme, l’individu n’a de valeur qu’en fonction de son utilité dans la perpétuation du système. Et comme dans le communisme ou le nazisme, les instances de régulation procèdent à l’élimination systématique des individus qui ne répondent plus à l’impératif de conformité – c’est la mise au rebut des éléments inaptes à remplir leurs objectifs. A la différence de ses épouvantables prédécesseurs toutefois, l’autorité suprême ne procède pas d’un chef ou d’un parti, mais d’un bilan comptable. La méthode est à peine plus douce : il s’agit simplement de persuader le travailleur qu’il n’a plus sa place dans la chaîne de production. Il ne lui reste plus qu’à se résigner – s’adapter ou périr. La question de la justice ou de l’injustice de telle ou telle décision s’efface derrière la nécessité scientifique : autrefois neutralisation des éléments contre-révolutionnaires ou élimination des individus biologiquement nuisibles, aujourd’hui renouvellement nécessaire des effectifs.
Plus insidieux encore, et c’est bien là qu’on touche au caractère totalitaire de l’entreprise capitaliste, l’homme de peine intègre peu à peu l’idée qu’il ne sera jamais suffisamment digne d’adhérer au système. Il ne sera jamais suffisamment motivé, convaincant, énergique, enthousiaste, en un mot il ne sera jamais assez rentable pour atteindre les objectifs assignés par sa hiérarchie. Qui elle-même ne sera jamais assez performante pour faire progresser le chiffre d’affaires de l’entreprise. Qui ne sera lui-même jamais à la hauteur des ambitions du conglomérat qui chapeaute la boîte. Employé, contremaître, cadre supérieur, directeur d’entreprise, potentiellement tous indignes. A chacun de prouver son innocence et sa docilité en atteignant le seuil de rentabilité qui l’autorisera à poursuivre son parcours au sein de la communauté. On n’a jamais fait mieux que la culpabilité pour tenir les hommes en laisse.
On voit ainsi que le néo-taylorisme mis en œuvre au sein de la plateforme d’appels, comme dans bien d’autres entreprises dans le monde, n’a pas pour seule conséquence de vider les êtres humains de leur chair : il tend aussi à assujettir leur esprit, à l’aliéner à un chiffre, un indice, un pourcentage, consécration de théories managériales aussi péremptoires qu’invérifiables. Historicisme marxiste, biologisme nazi, productivisme occidental : même logique de négation de l’individu au profit d’une Instance soi-disant supérieure. L’ultralibéralisme, ou quand la théorie rejoint la fantasmagorie. Le nettoyage par l’Idée, n’aurait pas manqué de ricaner Louis-Ferdinand Céline.
En état de choc, on suit la dérive de la médecin du travail Matthieu dans sa quête de vérité – une vérité minuscule, et d’autant plus précieuse qu’elle menace d’ouvrir grand les fenêtres sur ce cloaque. Au fil des pages, tandis que Carole Matthieu s’enferme dans sa logique mortifère, une question ne cesse de tarauder le lecteur : comment en sommes-nous arrivés là ? Comment pouvons-nous accepter aussi servilement les consignes ? Comment est-il possible d’endurer autant de brimades, de remises en cause, d’humiliations ? Comment aboutissons-nous à ce sentiment de claustration, à cette rumination épuisante autour de cas cliniques, à cette litanie sans fin de marques de médicaments ? La réponse est dans le roman, jamais énoncée, infiniment subtile : les personnages doivent suivre la procédure. Tel Joseph K en son château, les « visages écrasés » s’accrochent à une logique, une explication, un sursaut de rationalité face aux ordres et contrordres qu’une volonté capricieuse jette régulièrement dans leurs jambes. Plus que jamais, Kafka fait figure de visionnaire : l’homme occidental s’épuisera dans ses procédures. Ce que le génial Praguois n’avait toutefois pas prévu, et que Ledun exprime avec finesse, c’est que ces procédures allaient suivre un cours de plus en plus tortueux, imprévisible, absurde. Egarer pour mieux fidéliser : c’est à ce prix qu’on s’achète des employés modèles. L’entreprise du 21ème siècle, c’est l’union du château et de l’open space.
On sort pareillement sonné du roman de Marin Ledun. Pris aux tripes. Un peu nauséeux aussi. On n’a pas beaucoup vu la lueur du jour. On respire à grandes goulées. Et, paradoxalement, la rage qui innerve chaque page de ce livre a un effet thérapeutique. On se sent habité d’une conviction nouvelle. Non, ils ne me passeront pas dessus. Non, je ne m’abaisserai pas à faire n’importe quoi pour conserver un boulot que je méprise. Non, la machine à faire des chiffres n’a pas toujours raison. L’Homme n’est pas à vendre. Il reste cet être de chair et de déraison suffisamment fou pour refuser la loi des grands nombres et la fatalité des règles managériales.
Suffisamment rêveur aussi pour se dire, au milieu des ténèbres : ma vie m’appartient. Et il relève la tête vers la lumière. Qu’on se le dise : nul n’écrasera son visage.
Le Seuil, 2011.
Découvrez mon prochain article « Patrick SÜSKIND – Le Parfum »
Acheter le livre « Marin LEDUN – Les visages écrasés«
 Nick et Amy Dunne ont tout pour être heureux. Ils sont jeunes, la trentaine. Ils sont beaux. Ils sont libres, pas d’enfant à charge. Ils ont la vie devant eux. Sauf que… Comme tant d’autres, Nick a perdu son boulot dans le journal new-yorkais où il bossait depuis dix ans. Amy a elle aussi perdu son job. Pour elle, c’est moins grave : ses parents sont les auteurs très riches et très célèbres d’une fameuse collection de livres pour enfants : « L’épatante Amy ». Ils lui ont laissé une importante somme d’argent sur un compte en banque. Pas de problèmes financiers. Sauf que… La mère de Nick tombe malade – cancer. Son père sombre lentement dans l’Alzheimer. Sa soeur Margo appelle au secours depuis leur Missouri natal. Et Nick-le-looser décide que le temps du retour aux sources est venu. Il emprunte de l’argent à Amy – elle a dû restituer la plus grosse partie de sa fortune à ses parents, qui ont tout perdu dans le krach financier de 2007 – et ouvre un bar. En parallèle, il donne des cours de journalisme à la fac locale. La belle Amy, la New-yorkaise générique, s’ennuie dans cette vie provinciale. Les liens se distendent, le couple se fissure. Nick se comporte de plus en plus en connard égoïste et arrogant. Les disputes deviennent si fréquentes qu’Amy commence à craindre pour sa vie. Un beau matin, elle disparaît. Traces de lutte dans le salon, sang maladroitement épongé dans la cuisine… Effraction ? Enlèvement ? La police penche pour cette hypothèse. Sauf que… On trouve des cartes de crédit au nom de Nick Dunne. D’énormes dépenses ont été effectuées sur ces comptes. On s’aperçoit aussi que le plafond de l’assurance-vie d’Amy a été relevé peu de temps avant le drame. Et Nick ne semble pas plus affecté que cela par la disparition de sa femme. Il reçoit des appels mystérieux sur un second téléphone portable. On retrouve le journal intime d’Amy. Il révèle le désenchantement d’une femme amoureuse et peu à peu délaissée par un mari irascible, je m’en-foutiste et parfois violent. Bref, un meurtrier en puissance. Sauf que…
Nick et Amy Dunne ont tout pour être heureux. Ils sont jeunes, la trentaine. Ils sont beaux. Ils sont libres, pas d’enfant à charge. Ils ont la vie devant eux. Sauf que… Comme tant d’autres, Nick a perdu son boulot dans le journal new-yorkais où il bossait depuis dix ans. Amy a elle aussi perdu son job. Pour elle, c’est moins grave : ses parents sont les auteurs très riches et très célèbres d’une fameuse collection de livres pour enfants : « L’épatante Amy ». Ils lui ont laissé une importante somme d’argent sur un compte en banque. Pas de problèmes financiers. Sauf que… La mère de Nick tombe malade – cancer. Son père sombre lentement dans l’Alzheimer. Sa soeur Margo appelle au secours depuis leur Missouri natal. Et Nick-le-looser décide que le temps du retour aux sources est venu. Il emprunte de l’argent à Amy – elle a dû restituer la plus grosse partie de sa fortune à ses parents, qui ont tout perdu dans le krach financier de 2007 – et ouvre un bar. En parallèle, il donne des cours de journalisme à la fac locale. La belle Amy, la New-yorkaise générique, s’ennuie dans cette vie provinciale. Les liens se distendent, le couple se fissure. Nick se comporte de plus en plus en connard égoïste et arrogant. Les disputes deviennent si fréquentes qu’Amy commence à craindre pour sa vie. Un beau matin, elle disparaît. Traces de lutte dans le salon, sang maladroitement épongé dans la cuisine… Effraction ? Enlèvement ? La police penche pour cette hypothèse. Sauf que… On trouve des cartes de crédit au nom de Nick Dunne. D’énormes dépenses ont été effectuées sur ces comptes. On s’aperçoit aussi que le plafond de l’assurance-vie d’Amy a été relevé peu de temps avant le drame. Et Nick ne semble pas plus affecté que cela par la disparition de sa femme. Il reçoit des appels mystérieux sur un second téléphone portable. On retrouve le journal intime d’Amy. Il révèle le désenchantement d’une femme amoureuse et peu à peu délaissée par un mari irascible, je m’en-foutiste et parfois violent. Bref, un meurtrier en puissance. Sauf que…