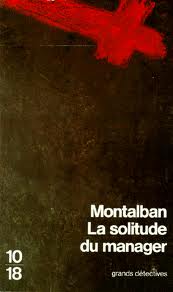Giorgio SCERBANENCO – Vénus privée
 Le nom de Giorgio Scerbanenco, né en Ukraine en 1911 et mort à Milan en 1969, ne dira peut-être pas grand-chose aux amateurs de polars. Il s’agit pourtant d’un des maîtres du genre, aussi à l’aise dans le format du roman que dans celui de la nouvelle. Certains de ses textes font une page à peine : cela lui suffit pour planter un décor, une ambiance et des personnages. On aura compris que de telles prouesses sont réservées à des auteurs exceptionnellement doués. Elles sont le fruit d’une longue pratique de l’écriture qui puise ses racines dans le journalisme. A l’instar d’un Simenon, qui a fait ses classes dans les gazettes populaires, Scerbanenco a d’abord travaillé pour la presse féminine avant d’écrire des romans alimentaires au kilomètre, puis de se tourner vers la littérature noire. De plus en plus célébré dans son pays, il devait atteindre la reconnaissance internationale avec sa série des Duca Lamberti.
Le nom de Giorgio Scerbanenco, né en Ukraine en 1911 et mort à Milan en 1969, ne dira peut-être pas grand-chose aux amateurs de polars. Il s’agit pourtant d’un des maîtres du genre, aussi à l’aise dans le format du roman que dans celui de la nouvelle. Certains de ses textes font une page à peine : cela lui suffit pour planter un décor, une ambiance et des personnages. On aura compris que de telles prouesses sont réservées à des auteurs exceptionnellement doués. Elles sont le fruit d’une longue pratique de l’écriture qui puise ses racines dans le journalisme. A l’instar d’un Simenon, qui a fait ses classes dans les gazettes populaires, Scerbanenco a d’abord travaillé pour la presse féminine avant d’écrire des romans alimentaires au kilomètre, puis de se tourner vers la littérature noire. De plus en plus célébré dans son pays, il devait atteindre la reconnaissance internationale avec sa série des Duca Lamberti.
« Vénus privée » est le premier tome des aventures de cet ancien médecin, fils de flic, et radié de l’Ordre pour avoir pratiqué l’euthanasie sur une vieille patiente cancéreuse qui le suppliait de mettre fin à ses souffrances. Trois années de prison plus tard, le voici chez un grand industriel milanais, le sieur Auseri. Petit homme précis et pressé, celui-ci lui confie la tâche de guérir son fils David d’un alcoolisme chronique. Depuis un an en effet, ce grand garçon taciturne et pas très futé se soûle au whisky du matin au soir. Pourquoi ? Mystère, et ce n’est sûrement pas à son père, autoritaire et vindicatif, que le jeune homme va se confier. Banal conflit des générations et des personnalités. A priori donc, rien d’intéressant pour un ancien médecin tout juste sorti de sa geôle. Sauf que ce Duca Lamberti n’est pas fait du même bois que les toubibs ordinaires, ces charcutiers humains. Dès qu’une vie est en jeu, aussi insignifiante puisse-t-elle paraître, il se déclare prêt à prendre ses responsabilités, moyennant un défraiement approprié.
Aucun angélisme chez Duca Lamberti : rien que du bon sens, une compréhension aiguë de la psyché humaine, et surtout une lucidité à toute épreuve. En bon clinicien, il diagnostique rapidement ce qui cloche chez le jeune David et lui applique une thérapeutique à sa façon. Première étape : le soustraire à la présence écrasante de son géniteur. Deuxième étape : vider quelques verres de gnôle en sa compagnie, histoire de faire connaissance. Troisième étape : le mettre en présence de filles faciles pour tester ses réflexes. Quatrième étape : le faire parler, en le sauvant du suicide au passage. Tout cela sans pathos, et avec une bonne dose de coups de pied au cul. Lamberti est un de ces hommes pour qui la gentillesse est toujours farouche. Timide, il n’est jamais timoré.
Le jeune colosse mutique parle enfin. Il raconte ses errances au volant de sa luxueuse voiture et ses rencontres furtives et tarifées avec des prostituées. Il évoque l’une d’elles en particulier, Alberta Radelli, ramassée un soir dans la banlieue milanaise. Pas spécialement séduisante, mais intrigante. Entre une partie de jambes en l’air et un whisky, elle lui propose de l’emmener avec lui. Peu importe la destination, tant que ce n’est pas Milan. La perspective de regagner la grande ville lombarde la terrorise littéralement, elle menace même de se tuer. David Auseri n’est peut-être pas un foudre de guerre, mais il comprend vite que cette fille a un grain. Il la largue donc au beau milieu de la zone, à Metanopoli. Tragique erreur : le lendemain, il découvre dans un journal que la fille s’est tranché les veines au beau milieu d’un pré. Le remords ne le quittera plus. Boire pour oublier, telle est l’impasse où s’enfonce le jeune David, vingt-deux ans, deux mètres, quatre-vingt-dix kilos et un complexe de culpabilité écrasant. Duca Lamberti, lui, ne croit pas à la thèse du suicide. Par chance, Alberta a égaré un rouleau de pellicules dans la voiture de David. Il contient des clichés pornographiques. On reconnaît Alberta et une autre fille, une blonde. L’esquisse d’une piste. Le médecin se lance dans l’enquête pour réparer le psychisme fracassé du jeune David.
Ce roman publié en 1966 fleure bon le frascati, les rues écrasées de soleil et les bistrots enfumés. On songe aussitôt à l’âge d’or du cinéma italien, à la « Dolce Vita » de Fellini et aux mauvais garçons de Pasolini : réalisme outrancier, mélange de burlesque et de tragique qui fait la grandeur des œuvres appelées à durer. Pas de lyrisme chez Scerbanenco : plutôt une observation froide et dépassionnée des animaux humains, une description désenchantée de tout ce que la société nous offre en pâture à fin de divertissement. En face de ce médecin sans illusions, on trouve des flics colériques et volontiers cogneurs, des filles à la cervelle d’oiseau, des vieux pervers, des maquereaux sans états d’âme, des jeunes intellectuelles obsédées par le sexe. Une belle brochette de tarés qui, sous l’œil d’aigle de l’auteur, prennent un tour ordinaire. Scerbanenco possède l’art de rendre le bizarre familier. Il y a de la douceur aussi, Lorenza, la jeune sœur de Duca Lamberti, et sa fille, la petite Sara. Voilà qui doit suffire à ne pas désespérer tout à fait de l’humanité.
L’intrigue n’est pas réellement novatrice : le roman vaut surtout par son atmosphère, poisseuse et fataliste. « Vénus privée » ressuscite une époque où tous les rêves étaient permis, croyait-on. En réalité, pressentait Scerbanenco, tous les pièges étaient déjà tendus. La société de consommation et son vide existentiel. Les préjugés qui figent hommes et choses dans un rôle prédéfini – et l’auteur lui-même n’échappe pas à un certain moralisme, qui paraît aujourd’hui assez daté. La course au plaisir, seul antidote à l’ennui. L’individualisme, qui mène à l’impasse de la solitude et à la servitude des plus faibles. L’argent, qui décide des destins. Scerbanenco nous dresse le portrait d’une société en plein boom et qui, sûre d’elle-même, fonce droit dans le mur.
Sa force réside dans une écriture extraordinairement précise. Chaque personnage est défini en quelques traits : le lecteur ne les lâchera plus des yeux. Lamberti compte les graviers d’une allée ; voici un homme scrupuleux et systématique. Le commissaire Carrua vocifère des banalités : l’éruptif dans toute sa splendeur. David Auseri ne dit mot, tel un jeune géant écrasé par un secret que son esprit trop lent et immature ne peut porter seul. Livia Ussaro ? Multi-diplômée, sans emploi et prostituée par scrupule intellectuel. Scerbanenco puise dans les faits divers la chair de ses récits, voilà pourquoi ils sonnent si juste, si vrai, si authentique. L’art de la prose est celui du détail révélateur : adossé à ce don d’observation hors normes, ce virtuose peut ainsi, en quelques coups de crayon, produire un texte d’une ou deux pages qui se suffit à lui-même.
Certes, l’écriture de Scerbanenco est celle des années 60. Certaines tournures semblent parfois désuètes – la traduction mériterait un sérieux coup de ripolin, ce à quoi s’attellent les éditions Rivages. Il subsiste encore une claire conscience du bien et du mal, et on s’applique à cerner les origines de celui-ci pour mieux encourager à faire celui-là. C’est qu’il ne fallait pas choquer les bonnes gens de la pieuse Italie, et l’univers de Scerbanenco est suffisamment sombre pour ne pas le noircir encore par un vocabulaire trop clinique. Mais le ton général est saisissant de rigueur et de précision : comme son héros Duca Lamberti, l’auteur va droit au but. S’il faut dire une vérité, ce médecin la dira, et sans ménagement encore bien. Dans un monde brutal et injuste, on n’obtient rien par la douceur. Il faut donc parler vrai et agir sans détour. Pas de faux-semblants ni de salmigondis psychanalytiques : Scerbanenco a une vision du monde behavioriste, l’homme est ce qu’il se fait, mais aussi ce qu’il se cache. Incision et précision, telle est la méthode de cet écrivain qui, paradoxalement, révèle plus du psychisme humain que bien des analyses savantes. Ce qui n’empêche pas ses personnages de s’emporter dans de grands discours ou dans des autojustifications alambiquées. Mais il ne s’agit que de mots, précisément, tout ce fatras de paroles qui dissuade l’être humain de regarder la réalité en face. Scerbanenco n’est jamais dupe. Son stylo a des grâces de bistouri. Chacune de ses nouvelles, notamment dans « Péchés et vertus », son meilleur recueil, s’apparente à une intervention chirurgicale.
Le roman noir comme application de la médecine légale : rares sont les écrivains qui, à l’image de Giorgio Scerbanenco, sont allés aussi loin dans l’art de l’autopsie littéraire.
Un incontournable.
Plon, 1966.
Découvrez mon prochain article « Douglas KENNEDY – Cul-de-sac »
Acheter le livre « Giorgio SCERBANENCO – Vénus privée«