Romain SLOCOMBE – Monsieur le Commandant
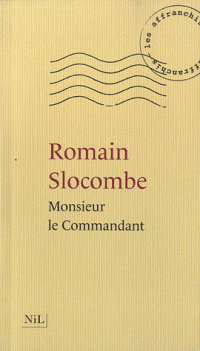 Voilà une lettre qu’on aurait aimé ne pas lire, et voilà un livre qu’il serait regrettable de manquer. La dernière page refermée, on le repose, encore sous le choc, partagé entre deux émotions : le dégoût devant cette confession en forme d’aveu, et l’empathie pour un narrateur, Paul-Jean Husson, qui se livre jusque dans ses secrets les plus intimes. Un salaud ? Un homme ordinaire pris au piège de circonstances extraordinaires ? On se souvient de l’adage de Simenon : l’essentiel est de comprendre, pas de juger. Penchons-nous donc sur le cas de Paul-Jean Husson.
Voilà une lettre qu’on aurait aimé ne pas lire, et voilà un livre qu’il serait regrettable de manquer. La dernière page refermée, on le repose, encore sous le choc, partagé entre deux émotions : le dégoût devant cette confession en forme d’aveu, et l’empathie pour un narrateur, Paul-Jean Husson, qui se livre jusque dans ses secrets les plus intimes. Un salaud ? Un homme ordinaire pris au piège de circonstances extraordinaires ? On se souvient de l’adage de Simenon : l’essentiel est de comprendre, pas de juger. Penchons-nous donc sur le cas de Paul-Jean Husson.
En 1942, année où il adresse cette missive au Sturmbannfürher Schollenhammer, cet homme de lettres de 66 ans est un auteur reconnu et couvert d’honneurs : prix Renaudot, juré Goncourt, académicien, il peut compter sur un public fidèle qui lui permet de vivre de sa plume et de jouir d’une certaine aisance dans sa propriété d’Andigny, calme sous-préfecture normande. Sa femme, la pieuse Marguerite, lui a donné deux enfants, Jeanne et Olivier. Ancien combattant de 14-18 et mutilé de guerre, Husson arbore une sensibilité conservatrice articulée autour de notions aussi nobles que la Famille, la Patrie et l’Honneur. A ce titre, il ne dissimule pas une franche sympathie pour la nation allemande, hier ennemie et vaincue, mais éternellement forte et conquérante. Rien à voir avec la France, ce pays à l’agonie gouverné par une clique de métèques, de socialistes et de francs-maçons. Bref, à l’instar d’un certain nombre de ses collègues, Paul-Jean Husson ne conçoit guère de sympathie pour la République. Il va sans dire que son cléricalisme intransigeant se teinte d’un antisémitisme bon teint, comme il sied à tout admirateur de la France immortelle.
1932. Olivier Husson, violoniste à l’orchestre de Paris, part en tournée à Berlin. Au retour, il rend visite à ses parents et leur présente sa fiancée, la blonde et diaphane Elsie Berger, jeune actrice de cinéma à la beauté foudroyante. Nonobstant sa condition d’écrivain catholique et de notable respectueux des usages, Paul-Jean Husson conçoit une vive attirance pour la jeune femme. Celle-ci épouse Olivier et donne bientôt naissance à une petite fille, Hermione. Une enfant aux cheveux noirs, au teint mat et au nez dangereusement crochu. Ravagé de désir autant que doute, Husson diligente une enquête auprès d’une agence de détectives privés. Bientôt, la terrible vérité se fait jour : Elsie Berger, de son vrai nom Ilse Wolffsohn, est juive.
1933. Un tremblement de terre plus fondamental encore se produit de l’autre côté de la ligne Maginot : Hitler s’empare du pouvoir avec une brutalité dont il ne se départira plus. C’est une excellente nouvelle pour Paul-Jean Husson, beaucoup moins pour sa belle-fille. Une longue descente aux enfers commence, pour les protagonistes comme pour leurs deux peuples. Et l’infamie se pare des atours de la grandiloquence pour produire une catastrophe dont la France subit aujourd’hui encore les répliques. Le lecteur tourne les pages sans pouvoir s’arrêter. Tout s’accélère, l’intrigue file, emporte les personnages dans un tourbillon de vanités et de violences…
On se souvient du choc que produisit « Le chagrin et la pitié » de Marcel Ophüls. Sorti en 1969, le film resta longtemps censuré. Il est certain que, publié à la même époque, le roman de Romain Slocombe aurait subi la même avanie. Il est vrai que certaines des vérités rassemblées dans ce livre splendide procurent une sorte de gêne, voire de nausée. Quoi ? Des écrivains de renom ont appelé à la collaboration franco-allemande dans un enthousiasme délirant ? Des plumes qui couraient dans toutes les gazettes et modelaient les contours de l’opinion publique réclamaient l’exil pour les apatrides, surtout d’origine sémite ? Quelques éléments prestigieux des lettres françaises criaient « Mort aux juifs » ? Jusqu’en 2012, ce rappel de faits peu glorieux plonge le lecteur dans l’inconfort et le désarroi. Certaines diatribes de Paul-Jean Husson soulèvent le cœur : c’est qu’il porte sur ses épaules le fantôme de ces hommes de lettres admirés en leur temps mais qui, par un concours de circonstances dont l’Histoire a le secret, ont sombré dans l’ignominie la plus crasse. On songe à l’éructant Brasillach, au perfide Maurras, à l’académique Abel Bonnard, à l’ignoble Rebatet, à l’opportuniste Jouhandeau, à l’intrigant Drieu la Rochelle, sans oublier Louis-Ferdinand Céline, écrivain génial mais homme misérable. On comprend de quel terreau ont germé ces pamphlets haineux et ces romans suintant la rancœur. Des notions telles que la pureté de la race et la terre qui ne ment pas, elles étaient déjà bien ancrées chez ces écrivains dont les obsessions quasi biologistes n’ont cessé de croître à mesure que se précisait le conflit mondial et que s’alimentaient les terreurs les plus irrationnelles. Pour un peuple aux abois, la logique du bouc émissaire demeure la seule échappatoire à la lâcheté. En 1940, les dirigeants de Vichy se sont rués sur cette aubaine avec une gourmandise de retraités. Quelques plumitifs exultaient. De nos jours, on reste stupéfait par un tel avilissement.
Mais voici que Simenon nous tire par la manche : comprendre, pas juger. C’est alors que Slocombe rejoint le maître, voire le dépasse, car il nous livre un personnage qui serait abject s’il n’était doté d’une carrure de héros. Ancien combattant, Paul-Jean Husson ne se dérobe jamais devant le danger. C’est ainsi qu’en dépit de son âge, il sauvera sa belle-fille et son enfant au moment de l’exode. Par la suite, il ne cessera de protéger la juive Ilse Wolffsohn des griffes de la Gestapo. Compassion chrétienne ? Amour véritable ? Les repères se brouillent, les sentiments aussi, sans parler des corps qui connaîtront des rencontres imprévues. Chez Husson, les motivations personnelles épousent souvent les convulsions de l’Histoire. Difficile de démêler ce qui le motive de ce qu’il exècre : il y a toujours une part de cécité dans un tel orgueil. Soudain, la justice immanente se présente sous la forme de policiers. La pire engeance que la politique de collaboration de Vichy ait suscitée : la Gestapo française, ramassis de voyous sans foi ni loi arborant cartes tricolores et cruauté à toute épreuve.
Le dénouement de ce terrible récit placera le pitoyable Paul-Jean Husson face aux conséquences de son aveuglement. Il rêvait de pureté de la race, de fierté patriotique et de redressement national ? Il sera témoin de la barbarie la plus insensée au cours d’une scène qui restera gravée dans les annales du roman noir. Fallait-il aller si loin dans la description de l’horreur ? Les bonnes âmes ne manqueront pas de s’émouvoir. Il faut pourtant regarder la réalité en face et appeler un chat un chat. Les tortionnaires, eux, n’avaient pas de ces pudeurs.
Pour dîner avec le diable, il faut se munir d’une longue cuiller… Paul-Jean Husson, écrivain catholique et conservateur, n’avait qu’un stylo à sa disposition. Mais avec ce simple objet, que de dégâts n’a-t-il pas commis, que de meurtres n’a-t-il pas couverts… La belle Ilse y survivra-t-elle ? C’est l’enjeu de ce roman magnifique et passionnant de bout en bout, écrit dans une langue classique à la pureté adamantine. Travail d’orfèvre, ciselé, qui restitue à la perfection l’esprit d’une certaine catégorie de la population à une époque très particulière : la France maréchaliste, revancharde, sûre de son bon droit et de ses principes moraux. C’est là que l’auteur fait mouche : le personnage de Paul-Jean Husson n’est pas l’un de ces nazis de fortune, cyniques et mal dégrossis, mais un esthète pétri de bonnes intentions et qui a toujours sa conscience pour lui. Irréprochable, il mènera jusqu’à leur terme les combats qui lui paraîtront justes. Entre grandeur littéraire et décadence morale, le personnage central de Slocombe prend toute son envergure humaine. Là où le héros de Simenon finit par admettre sa culpabilité, moyennant un certain nombre de circonstances atténuantes qui pondère le jugement et arrache des soupirs de résignation à Maigret, Paul-Jean Husson garde la tête dans le sable et se justifie ad nauseam. Jamais il n’acceptera d’en démordre : il a eu raison de faire ce qu’il a fait, contre toute évidence et toute humanité. Il ne souhaite la mort de personne mais, mis au pied du mur, il préfère encore une idée pure à un être humain qui ne le sera jamais assez. Dolorisme chrétien, idéalisme incantatoire et haine de la différence se conjuguent pour produire une mécanique de mort d’une terrifiante efficacité. On réalise soudain la profondeur de l’ornière dans laquelle la France a versé en 1940 : face au sauve-qui-peut général, les gens étaient prêts à se raccrocher à n’importe quelle branche, fût-ce un maréchal à la retraite qui était aussi, on l’oublie parfois, ambassadeur de France auprès du général Franco au moment du déclenchement des hostilités. Le ton était donné. La législation anti-juive était dans les cartons. La vérité dérange, mais ce roman nous la met sous les yeux, sans fard. Il dresse le portrait saisissant d’une France vaincue, humiliée, mais prête à toutes les concessions pour continuer à simuler la grandeur. « Monsieur le Commandant » livre un tableau d’une extrême justesse sur la France occupée : ni lâche ni courageuse, simplement résignée. La barbarie fasciste avait trouvé son terrain de prédilection.
Quant à cette intelligentsia qui a donné quitus au galonné, ce n’était qu’une frange tout à fait minoritaire de la population, mais son influence a été décisive dans l’instauration d’un gouvernement qui a élevé la compromission au rang de vertu. En ayant table ouverte dans les grands quotidiens, les revues de référence et les principales maisons d’édition, ils ont constitué l’alibi culturel de la bassesse. Trop heureux de l’aubaine, l’occupant nazi s’est délecté de tous ces égarements pour creuser des fossés entre les Français. Le hic, c’est que les écrivains collaborationnistes, même les plus épouvantables, se sont engagés dans cette voie en toute bonne foi, animés par un idéal ardent. Prophètes exaltés, ils ont cautionné les pires turpitudes avec la conviction de préparer des lendemains qui chantent. Jusqu’au bout, ils ont refusé de voir la véritable nature du régime qu’ils appelaient de leurs vœux. Adossés à leur principe d’autorité, ils ne pouvaient admettre qu’en s’abouchant avec la bête immonde, ils commettaient un crime contre l’esprit, tant il est vrai que les écrits aussi sont les combustibles de la haine. Une erreur très humaine, certes, mais dont les conséquences furent incommensurables.
Grâces soient rendues à Romain Slocombe de nous rappeler l’existence de tous ces Paul-Jean Husson. Au fil de ce roman haletant et fort bien documenté, l’auteur ramène ces personnages à la vie avec leurs paradoxes et leur incroyable complexité. Qu’on le veuille ou non, ces hommes de lettres étaient aussi des hommes de chair et de sang. Leur égarement n’excluait pas le talent. Tous ont eu leur heure de gloire. La plupart ont glissé lentement dans les caniveaux de l’Histoire. Ils y croupissent pour l’éternité, espérons-le.
Hélas, de temps à autre, les remugles de leur pensée remontent à la surface. Les dernières échéances électorales ont prouvé à quel point ils peuvent être insinuants.
Nil, 2011.
Découvrez mon prochain article « Harry CREWS – Le Chanteur de Gospel »
Acheter le livre « Romain SLOCOMBE – Monsieur le Commandant »
