Manuel VASQUEZ MONTALBAN – La solitude du manager
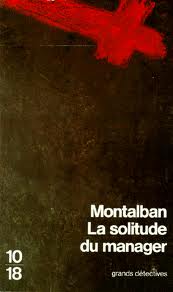 S’il est un auteur qui a transcendé le genre de la littérature policière, c’est bien le grand écrivain catalan Manuel Vázquez Montalbán (1939-2003). L’anecdote est fameuse : face à l’insuccès de ses premiers romans, « Au souvenir de Dardé » et « J’ai tué Kennedy » (plutôt avant-gardistes et assez peu enthousiasmants, il faut en convenir), Montalbán avait fait le pari d’écrire un polar en trois semaines. Une pure réaction d’orgueil. Reprenant le personnage principal de « J’ai tué Kennedy », Pepe Carvalho, ancien agent de la CIA devenu détective privé, il écrivait d’une traite « Tatouages ». Et rejoignait d’emblée le cercle très fermé des incontournables du roman noir. Ironie de l’Histoire…
S’il est un auteur qui a transcendé le genre de la littérature policière, c’est bien le grand écrivain catalan Manuel Vázquez Montalbán (1939-2003). L’anecdote est fameuse : face à l’insuccès de ses premiers romans, « Au souvenir de Dardé » et « J’ai tué Kennedy » (plutôt avant-gardistes et assez peu enthousiasmants, il faut en convenir), Montalbán avait fait le pari d’écrire un polar en trois semaines. Une pure réaction d’orgueil. Reprenant le personnage principal de « J’ai tué Kennedy », Pepe Carvalho, ancien agent de la CIA devenu détective privé, il écrivait d’une traite « Tatouages ». Et rejoignait d’emblée le cercle très fermé des incontournables du roman noir. Ironie de l’Histoire…
« La solitude du manager » fait partie des premiers polars de Montalbán. C’est aussi l’un des plus réussis, et le plus représentatif de ce que deviendra l’univers du célèbre détective Pepe Carvalho. Tout commence par un flash-back. Un voyage en avion, entre Las Vegas et San Francisco. Une rencontre imprévue entre Carvalho et Antonio Jauma, directeur de la filiale espagnole d’une multinationale américaine, la Patnay. L’homme d’affaires est exubérant, fort porté sur la bonne chère, la boisson et les femmes. Bref, il fuit le stress inhérent à l’existence d’un grand manager dans une quête effrénée des plaisirs. Et, paradoxalement, se dit socialiste dans une Espagne qui vit les dernières heures du franquisme.
Quelques années plus tard. Antonio Jauma est retrouvé assassiné dans un terrain vague, quelque part dans la lointaine banlieue de Barcelone. Une balle dans la peau. Détail amusant : il ne porte pas de slip, mais cache une culotte de femme dans la poche de son manteau. Meurtre crapuleux, conclut la police. La veuve de Jauma, la belle Concha Hijar, ne croit pas à cette explication. Elle demande à Pepe Carvalho de mener l’enquête. La chose est possible, moyennant un défraiement de cent mille pesetas et une avance pour les frais (en ce temps-là, l’euro n’était même pas envisageable). Accepté. Le détective s’engage dans une suite de rencontres avec les relations connues de la victime… Après ce singulier préambule, l’intrigue vous saisit au vol. Elle ne vous laissera plus un instant de répit.
Cependant, on perçoit très vite que la virtuosité du conteur cache une ambition. L’enquête du détective n’est qu’un prétexte : ce qu’esquisse Montalbán en filigrane de son récit, c’est le portrait d’une société et d’une époque, l’Espagne à peine libérée de l’étouffoir franquiste. Les plus jeunes auraient du mal à se représenter ce que fut cette dictature, ce sinistre opéra-bouffe inauguré dans la fureur d’une guerre civile et qui devait se perpétuer durant plus de trente-cinq longues années entre hystérie catholique et répression policière. Toute l’œuvre de Montalbán est marquée par ces années de ténèbres et l’obscurantisme qui en découla. Il ne faut jamais perdre de vue que l’auteur en fit personnellement les frais : il connut la prison en tant que militant communiste et subit les foudres de la censure, omniprésente. Ce contrôle incessant de la pensée l’obligea à publier ses premiers récits dans un louvoiement stylistique qu’il qualifia lui-même de sub-normal : seules l’enflure et l’exagération peuvent témoigner de l’absurdité d’un système dictatorial (au risque de lasser le lecteur par un usage trop systématique de l’hyperbole).
Tout change à la mort de Franco. Dès 1975, l’Espagne entame sa mue démocratique : la movida est en marche. En pénétrant par effraction dans l’univers du roman noir, Montalbán se fait le chroniqueur malgré lui de cette Espagne désinhibée, décomplexée, qui s’ouvre enfin au monde et veut croquer la vie à belles dents. Mais la libération des cervelles et des pantalons ne doit pas cacher le vide qui attend cette génération rongée de désirs, donc d’insatisfaction : à l’instar du détective Carvalho, son personnage fétiche, Montalbán jette un œil distancié et ironique sur ces hommes qui avaient vingt ans au début des années 60. Les anciens révolutionnaires ont enfin pignon sur rue et voix au chapitre. Surprise : ils sont devenus businessmen, avocats d’affaires, intellectuels de renom, écrivains sans lecteurs. Les grands idéaux sont brandis comme des talismans, dans l’espoir vain de dissimuler une volonté forcenée de compensation. C’est qu’il faut rentabiliser les années perdues, accumuler l’argent qu’on n’a pas gagné, étaler le luxe qu’on n’a pas pu s’offrir, éditer les livres enfermés dans les tiroirs. Toute honte bue, l’Espagne du post-franquisme passe du silence à la jouissance, de la consomption à la consommation. Le rêve de justice sociale n’y survivra pas.
Le détective Pepe Carvalho, c’est le double de l’auteur : un fin gourmet dur en affaires, un désabusé pugnace, un sensuel qui camoufle sa sensibilité. Il porte sur le monde un regard d’entomologiste vaguement diverti par les mouches humaines, s’attachant à comprendre leur vol, leur bourdonnement, leurs errances frénétiques. Incurable redresseur de torts, il s’attache à mener ses enquêtes à leur terme, quand bien même il sait qu’elles le conduiront à un idéologue cuirassé de certitudes, un homme d’affaires trop riche pour être inquiété ou un politicien intouchable. En bon « communiste nostalgique et hédoniste » (ainsi qu’il aimait à se définir), Montalbán a suffisamment éprouvé les principes intangibles de la domination pour décrire l’humanité au plus juste, entre ironie distanciée et soupir exhalé entre deux bouffées de cigare. Les années de plomb de la dictature avaient alimenté l’espérance : celle-ci perdue, ne reste que le poids de la nostalgie, qui n’est pas négligeable. Ironie de l’Histoire, encore une fois… Mais il est difficile de s’abandonner au présent avec un tel passé, de fuir le confinement d’une société fermée à double tour pour s’enivrer dans l’univers aseptisé d’un supermarché. Sans doute les nombreuses références au contexte politique des années 60 et 70 peuvent-elles sembler anachroniques au lecteur d’aujourd’hui. Elles sont simplement le reflet d’une époque où l’on s’attachait encore à déplorer la fin des idéaux, avant d’en dresser le catalogue dans les livres d’histoire. Ou de les commercialiser en tee-shirts à l’effigie du Che.
Le génie de Montalbán est d’avoir compris que l’univers tout entier tenait dans une ville, sa ville, son laboratoire devrait-on écrire : Barcelone. Il excelle à rendre l’atmosphère de la cité catalane, le petit peuple des ramblas, les restaurants bruyants, les clubs où les regrets s’échangent contre des coucheries, les demeures bourgeoises dont l’opulence peine à cacher le désarroi existentiel. Le monde selon Montalbán, ce sont aussi ces personnages truculents que l’on retrouve de récit en récit, le fidèle Biscuter, ancien taulard devenu homme à tout faire du détective, Charo la pute au grand cœur, et Bromure, l’ancien milicien franquiste reconverti en cireur de chaussures et, tant qu’à faire, en indicateur de police. Sur les hommes et les choses, Carvalho promène son regard amusé et désabusé, pénétré de la conviction qu’aucune idée ne vaut qu’on vive, ni qu’on meure, pour elle. Il a tâté du communisme de parti, il a expérimenté la prison, il a tué pour de l’argent. L’idéalisme, très peu pour lui. « Moi aussi j’ai eu mes idées, à présent il ne me reste plus que quelques viscères en très bon état. » Telle est la philosophie du détective Pepe Carvalho. Qui remarque au passage que pour allumer un feu de cheminée, rien ne remplace un bon livre.
Alors fataliste, Montalbán ? Non, car il reste la littérature, un style digne de la cathédrale de Gaudi et des formules à couper le souffle. L’œil expressionniste de Pepe Carvalho a des grâces de scalpel, il voit tout et n’épargne rien. D’une scène de trafic : « Génératrices de froid, les bicyclettes zigzaguent avec leur lumière folle, nerveusement étudiées par les yeux fumants des phares d’auto ou par l’iceberg d’un camion dont seul émerge le front d’un gigantesque animal cubique. » D’un intellectuel de gauche : « Doué pour l’amitié, tant pour la recevoir que pour la donner toujours à la suite d’un marchandage sadique, il utilisait une agressivité verbale permanente quand il s’agissait de qualifier amis et ennemis. » D’un grand dirigeant d’entreprise : « Son stylo eût été de cristal, il ne l’aurait pas fermé autrement. » Au fil des pages, la plume de Manuel Vázquez Montalbán se trempe dans l’encre la plus noire pour graver des blessures de toute beauté. C’est toute l’Espagne de l’après-dictature qui est passée au crible d’un regard trop lucide pour ne pas être tendre. On ne le dira jamais assez : Montalbán est l’un des plus grands écrivains de langue espagnole, ce qui explique sa popularité auprès de lecteurs de toutes obédiences. Comme en écho, sa production romanesque balaie la plupart des horizons : polars, thrillers historiques, théâtre, romans de mœurs, espionnage, et même livres de cuisine. En écrivain universel, Montalbán transcende les modes et les genres.
C’est en 1977 que « La solitude du manager » paraît en Espagne, et on demeure stupéfait par l’actualité du propos : des multinationales omnipotentes, une bourgeoisie résignée à l’hédonisme, une élite arc-boutée sur ses privilèges, un petit peuple soucieux de survie. L’argent-roi, le pouvoir qui rend fou, l’ordre protégé par les charges de police, l’humanité foulée aux pieds. Une société qui broie les hommes, fussent-ils de hauts managers, pour s’abandonner à la logique des marchés. Visionnaire, Montalbán ?
Oui, hélas. L’auteur aura vécu suffisamment longtemps pour assister à la réalisation de ses prédictions. Pas sûr qu’il en ait conçu un quelconque orgueil…
Ironie de l’Histoire, suite et fin : cet écrivain qui s’est toujours gaussé des honneurs possède aujourd’hui une place à son nom, rambla du Raval. Au milieu de ces petites gens sur lesquels il n’a cessé de poser un regard fraternel.
Christian Bourgois, 1981.
Découvrez mon prochain article « Tonino BENACQUISTA – La machine à broyer les petites filles »
Acheter le livre » Manuel VASQUEZ MONTALBAN – La solitude du manager «
