René-Victor PILHES – L’imprécateur
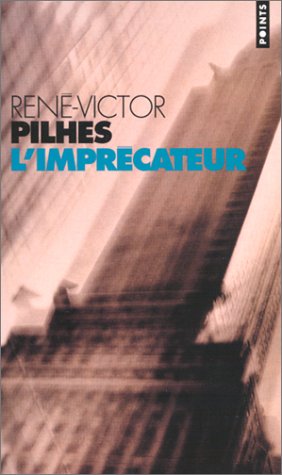 Et si la victime était une entreprise ?
Et si la victime était une entreprise ?
En partant de ce constat simple et efficace, René-Victor Pilhes a conçu l’un des thrillers les plus jouissifs de ces dernières décennies. Près d’un demi-siècle a passé sans entamer la force de frappe de ce roman palpitant, à l’ironie mordante. Méga-best-seller dès sa sortie en septembre 1974, ce récit met en scène l’effondrement de la filiale française de Rosserys & Mitchell, une gigantesque multinationale américaine. Les rebondissements s’enchaînent sans temps mort. A la grande surprise de ces cadres supérieurs que rien ne prédisposait à ces aventures, il apparaît que le lieu de travail peut, lui aussi, s’avérer plein de périls.
Quoi de plus anonyme, à première vue, que cette tour de verre et d’acier de onze étages qui s’élève au coin de l’avenue de la République et de la rue Oberkampf ? Nonobstant sa taille, ce serait un immeuble de bureaux ordinaire s’il n’abritait le siège de la filiale française de la plus grande multinationale du monde, Rossery & Mitchell. Cette firme dont l’ombre s’étend aux quatre coins de la planète fabrique, emballe et vend des engins agricoles. On mesure l’importance de l’enjeu : grâce à elle, des millions de gens peuvent travailler, récolter et manger chaque jour à leur faim. Parlons net : Rosserys & Mitchell tient le sort du monde entre ses mains.
Le récit s’ouvre sur une succession d’événements étranges et sans lien apparent. C’est d’abord l’annonce de la mort de Roger Arangrude, sous-directeur du marketing pour le Benelux, qui s’est tué la veille dans un accident de voiture. C’est ensuite la découverte d’une fêlure dans les soubassements de la tour. Enfin, et plus stupéfiant encore, c’est la mise à la disposition du personnel d’un étrange document, un parchemin fermé d’un ruban vert et noir. Dans ce texte, qui présente en termes caustiques quelques rudiments de science économique, l’auteur moque les pseudo-compétences des dirigeants de Rosserys & Mitchell, en particulier celles de Henri Saint-Ramé, son très estimé et très respecté Directeur général.
Tout cela a de quoi bouleverser le narrateur, directeur adjoint des Relations humaines. Soucieux de servir au mieux les intérêts de son entreprise, il s’empare de ces problèmes à bras-le-corps. Contre la fêlure découverte dans l’un des murs porteurs, il ne peut pas grand-chose dans l’immédiat, sinon en référer aux services compétents. Après une réunion tendue avec Henri Saint-Ramé et l’intrigant Roustev, sous-directeur général, il rend visite dès 16 heures à la veuve d’Arangrude : la multinationale Rosserys & Mitchell honore toujours ses serviteurs, surtout dans des circonstances aussi tragiques. Quant au mystérieux parchemin, le narrateur tente d’en mesurer l’impact sur le personnel de Rosserys & Mitchell. Il apparaît que le contenu sibyllin du message provoque railleries et ricanements. Si l’on n’y prend garde, c’est l’état-major de Rosserys & Mitchell dans son intégralité qui sera victime de la risée générale. Perspective inadmissible. Henri Saint-Ramé charge notre héros de mettre la main sur cet étrange imprécateur. Cornaqué par des détectives venus en droite ligne de la maison-mère de Des Moines, Iowa, le directeur adjoint des Relations humaines – qui, nous l’apprendrons à la fin du livre, se nomme Pilhes – découvre bientôt que d’étranges conciliabules réunissent certains des principaux décideurs de Rosserys & Mitchell. Il va aller de surprise en surprise, jusqu’à l’incroyable dénouement.
Rares sont les romans qui parviennent à passionner le lecteur jusqu’à la dernière page dans un milieu aussi peu fantasmatique que celui d’une grande multinationale occidentale du XXème siècle. Dépeinte à la manière d’une matrice, elle est le réceptacle de toutes les ambitions, de tous les bonheurs et de toutes les craintes de ceux qui la font vivre et vivent à travers elle. Les cadres de Rosserys & Mitchell, les Saint-Ramé, Roustev, Le Rantec, Brignon, Terrène, Yritieri et consorts n’existent que par le truchement de cette entité aussi révérée qu’une déesse profane. Elle seule a le privilège de dispenser la grâce : bien plus qu’une place dans un organigramme, elle offre une raison d’être à ses thuriféraires. Les différents protagonistes s’accrochent à l’échelon qu’ils ont atteint dans la hiérarchie, le but étant de s’élever autant que possible vers l’homme qui les éclaire de sa sagesse et de son omniscience, l’illustre Henri Saint-Ramé. Comment s’étonner que la seule inquiétude qui s’empare du personnel à l’annonce de la mort d’Arangrude, c’est : qui va le remplacer ?
Sous des dehors de mémorandum en trois points, le roman offre une peinture acerbe de la vie dans une de ces gigantesques multinationales qui gouvernent le monde. La politesse glacée ne cache que des luttes d’ego. L’autorité se manifeste par de petites mesquineries, qu’on aurait tort de sous-estimer : le moindre manque de vigilance peut s’avérer fatal, comme l’expérimentera Le Rantec. Les allées et venues dans les couloirs n’ont pas pour seul objectif de se déplacer au sein de la matrice : il s’agit de marquer son territoire, quitte à espionner, traquer, voire dénoncer son collègue. Car la délation surviendra, inévitable : c’est la survie de l’entreprise qui est en jeu. Ainsi que le répète à l’envi le mystérieux imprécateur, Rosserys & Mitchell est engagée, comme toutes les autres multinationales de son envergure, dans la guerre économique. Loués soient ceux qui la mèneront à la victoire finale. Et que Dieu les protège tous.
La plus grande réussite de ce roman ambitieux réside bien dans ce ton à la fois emphatique et dérisoire. Le style, d’une grande fluidité, fait d’autant plus ressortir l’insigne médiocrité des destinées qui lui sont assujetties. Au terme d’un véritable tour de force littéraire, René-Victor Pilhes réussit à faire de ces cadres gris, ternes et dépourvus d’imagination les héros d’une authentique épopée. Ils sont pourtant extraordinairement ordinaires, ces hommes – car il n’y a que des personnages masculins dans cette histoire – qui trimballent comme ils le peuvent une armure bien trop grande pour eux, égarés dans un combat qui les dépasse infiniment. Bien que l’auteur s’ingénie à les placer dans les situations les plus fantasmagoriques, ils ne se départissent jamais de leur sérieux, convaincus de l’importance de leur mission. Leurs titre, diplôme et fonction seront rappelés sans relâche, et leurs principaux traits de caractère analysés lorsque les circonstances s’y prêteront. Tout le charme de ce roman tient dans ces personnages qui deviennent instantanément familiers au lecteur : ces hommes en costume gris muraille et attaché-case, on les croise à longueur de journée au coin des rues ou dans les couloirs du métro. Ils sont l’insignifiance incarnée mais sous la plume de Pilhes, ils se voient dotés d’une dimension nouvelle, quasi messianique : voici les croisés des temps nouveaux, honneur à ceux qui s’en vont conquérir le graal de la performance. Placées sous les feux d’un style pompeux et pince-sans-rire, ces fourmis qui se prennent pour des géants suscitent une authentique jubilation.
L’autre réussite de ce thriller tient dans l’économie de sa narration : les péripéties s’enchaînent selon une logique kafkaïenne, une absurdité en entraînant une autre plus singulière encore. Des cadres en costumes se réunissent dans des entrepôts abandonnés, une veillée funèbre se tient dans le hall de l’entreprise, une visite des sous-sols dérape en règlement de comptes : tout se passe comme si l’extravagance était le pendant naturel du conformisme entrepreneurial. On ne sait ce qui est le plus déconcertant dans cette peinture de mœurs : les situations ubuesques auxquelles sont confrontés les cadres de la multinationale Rosserys & Mitchell, ou leur absolue soumission à l’autorité. Pilhes hoche la tête, fataliste : par obéissance, par désir de reconnaissance aussi, ces hommes sont prêts à tout. Ils s’abaisseront aux pires humiliations et aux plus infâmes trahisons pour affirmer leur place dans l’entreprise. Imbus de leurs prérogatives, ils se lancent dans de grands et vains discours, façonnés dans la plus pure langue de bois managériale. La moindre de leurs démarches prend des allures sacramentelles : ils se persuadent eux-mêmes que l’entreprise sauvera les hommes. A terme, le monde ne sera plus qu’une seule et tentaculaire entreprise. L’économie est la religion des temps nouveaux et le gestionnaire est son prophète.
Les intentions de l’auteur se font enfin jour : sous le couvert d’un thriller habilement mené, René-Victor Pilhes nous plonge au sein du processus de domination. L’entreprise étant devenue l’horizon indépassable de l’humanité, il ne reste plus qu’à s’agenouiller ou à disparaître. Au fil des pages, le dilemme se resserre autour du cou du héros-narrateur, qui s’accroche à son rôle d’enquêteur avec l’énergie du désespoir. C’est moins la justice qu’il défend que sa survie dans le corps liturgique de la firme. Comme toutes les religions, celle-ci est un léviathan qui finit par dévorer ses serviteurs : son règne est sans fin et son avidité sans limites. Elle exige le dévouement de tous, et tant pis pour ceux qui finiront broyés dans les engrenages de la compétition. Le marché est sans pitié : confrontées aux exigences de la rentabilité maximale, les entreprises elles-mêmes ne sont jamais à l’abri de l’anéantissement. C’est ce que nous rappelle ironiquement la fissure qui ne cesse de s’élargir dans les soubassements de la tour.
Il est d’autant plus intéressant de relire « L’imprécateur » que son action se situe en 1974, soit longtemps avant la chute de l’empire soviétique et l’avènement totalitaire de l’ultralibéralisme. Les relations entre les hommes y sont dures, marquées par la méfiance et l’hypocrisie. Avec le recul, on s’aperçoit pourtant que l’imprécateur est encore bien miséricordieux vis-à-vis de ces braves cadres dont toute la carrière se déroulera, sauf accident, sous les auspices protecteurs de Rosserys & Mitchell. Il était difficile d’imaginer le licenciement de milliers de salariés à seule fin d’améliorer le cours d’une action. Ou les conduites d’intimidation et de terreur de la part de managers qui s’assimilent à des psychopathes en col blanc. Sans oublier les déménagements nocturnes d’usines entières et leur relocalisation dans des pays où les salariés sont réduits à l’état d’esclaves. Tout cela était impensable mais l’on sait que la réalité, cette compétitrice-née, ne demande qu’à dépasser la fiction.
L’entreprise, nous dit René-Victor Pilhes, porte en elle les germes de la barbarie. La course à la performance et son corollaire, la nécessaire soumission à l’autorité, débouchent inévitablement sur un processus darwinien de lutte de tous contre tous, prémices à une impitoyable sélection industrielle. L’eugénisme économique est en marche : les procédures de gestion assèchent les terres et épuisent les hommes à une cadence de plus en plus soutenue. Quant aux arbres de la croissance, ils portent maintenant des fruits, superbes et vénéneux.
Le Seuil, 1974.
Découvrez mon prochain article « Robin COOK – On ne meurt que deux fois »
Acheter le livre « René-Victor PILHES – L’imprécateur«
