Nick TOSCHES – La religion des ratés
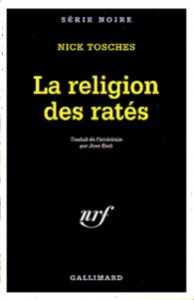 L’Amérique est bonne mère. Elle a engendré le polar, l’a vu grandir, se perdre parfois dans la facilité, mais elle a toujours encouragé ses fils, même les plus turbulents, à découvrir de nouvelles voies. Elle les a tous aimés, quelle que soit leur manière : James Ellroy l’obsessionnel, Edward Bunker le vicieux, Harry Crews le foutraque, James Crumley le dur à cuire, Marc Behm le déjanté… Dans cette galerie de portraits, une silhouette se détache lentement, sans se presser. Haute stature légèrement voûtée, allure de dandy, sourire las, regard foudroyant. Voici que s’avance Nick Tosches, l’un des plus grands stylistes du genre.
L’Amérique est bonne mère. Elle a engendré le polar, l’a vu grandir, se perdre parfois dans la facilité, mais elle a toujours encouragé ses fils, même les plus turbulents, à découvrir de nouvelles voies. Elle les a tous aimés, quelle que soit leur manière : James Ellroy l’obsessionnel, Edward Bunker le vicieux, Harry Crews le foutraque, James Crumley le dur à cuire, Marc Behm le déjanté… Dans cette galerie de portraits, une silhouette se détache lentement, sans se presser. Haute stature légèrement voûtée, allure de dandy, sourire las, regard foudroyant. Voici que s’avance Nick Tosches, l’un des plus grands stylistes du genre.
« La religion des ratés » est son premier roman. Inutile de tourner autour du pot : coup d’essai, coup de maître, coup d’éclat, coup de poing dans la gueule. Rares sont les auteurs qui imposent d’emblée leur atmosphère. Celle de Tosches oscille entre résignation et bouillonnement tripal, complainte et hurlement – Nick Tosches ou l’élégance du désespoir.
New York, début des années 80. Luigi, dit Louie, est un petit truand minable, un usurier à la manque qui court après son argent. Agé d’une bonne trentaine d’années, il entretient une relation orageuse avec Donna Lou, une jeune et belle dessinatrice. Son QG, c’est le bar de nuit du vieux Giacomo. Là-dedans végète une faune d’alcoolos, de mythomanes, de camés et de vieux mafieux comme Frank « Il Capraio » Scarpia, ou son homme de main, le sinistre Joe Brusher qui tue comme d’autres se mouchent. Et bien sûr, bourdonnant par-dessus tout ça, les bookmakers.
Le jeu. Voilà la grande affaire. Tout le monde parie à peu près sur tout. Et perd, parfois beaucoup. C’est alors qu’arrive Louie, le compagnon de la débine, la providence des poissards. Il prête de l’argent, à un taux prohibitif évidemment. Louis n’a que mépris pour les joueurs, ces pauvres types qui se sont trompés de rêve : la chance, c’est la religion des ratés. Et l’usure, « l’arithmétique de l’inutile », selon ses propres termes. Comme il vit de leur faiblesse, il s’épanouit sur leur dèche. C’est sa chance et sa malédiction à la fois : il a choisi ce mode de vie parce que, fondamentalement, il est comme eux, un pauvre type tiraillé entre son intelligence – quand il est question de taux d’intérêt et d’échéancier, Louie devient un véritable ordinateur ambulant – et ses instincts les plus médiocres.
Louie a toujours gravité dans le petit monde des books. Il a de qui tenir : son oncle, Giovanni Brunellesches, a été le créateur des loteries clandestines à la fin des années 1920. Grâce à cet attrape-gogos, il aurait pu se faire des montagnes de fric. Mais, faiblesse ou imprévoyance, c’est surtout son rival, Frank « Il Capraio » Scarpia, qui a tiré les marrons du feu. Il ne fallait pas faire confiance… L’oncle Giovanni a continué son petit bonhomme de chemin dans la pègre, vaille que vaille. Le voilà au crépuscule de sa vie et il rêve de finir ses jours dans son village natal, Casalvecchio, un bled minable au fin fond de la botte de l’Italie. Perspective plutôt étrange pour quelqu’un qui n’a pour ainsi dire jamais quitté le quartier de Little Italy à Manhattan. Autre bizarrerie, le vieux Giovanni a déjà son passeport tout prêt. Et voilà même qu’il se fait installer le téléphone… Tant d’extravagance a de quoi surprendre Louie et son solide bon sens de truand. A moins qu’il n’y ait anguille sous roche. Il apparaît bientôt qu’il sera, à son insu, mêlé à une étrange affaire… Car dans ce petit monde, la vie est un livre de comptes qu’on ne ferme que lorsque toutes les dettes sont apurées.
« La religion des ratés » vaut tant par l’ambiance qui s’en dégage que par l’intrigue proprement dite. Nick Tosches ressuscite un New York oublié, à cheval entre les années 70 et 80. Lorsqu’on se balade aujourd’hui entre les boutiques de luxe et les restaurants végétariens, il est difficile d’imaginer qu’en ces années-là certains quartiers de Soho et de Tribeca étaient laissés à l’abandon. Entrepôts désaffectés, immeubles borgnes, impasses jonchées de débris, autant de lieux propices aux règlements de comptes. On est à des années-lumière du New York brillant et raffiné de Woody Allen. D’ailleurs, les personnages de Tosches font pâle figure dans le casting… Entre les poivrots, les tenanciers de sex-shops, les yuppies accros à la coke, les belles de nuit prêtes à s’ouvrir le cœur pour le premier crétin venu ou les vieux capos mafieux racornis dans leurs souvenirs et leurs rancoeurs, il y a peu de place pour la lumière. Louie a toutes les cartes en main pour sortir du lot : il est intelligent, perspicace et bien plus cultivé que la moyenne. Mais comme tous les joueurs, il ne résiste pas à ses tendances autodestructrices. Il suffit qu’il gagne un peu de fric pour qu’il le claque dans des paris débiles. Il boit un verre ? Il ne dessoûle plus pendant une semaine. Il aime Donna Lou ? Il fait tout pour saboter leur relation. Louie ne vaut pas mieux que ces épaves dont il pressure le portefeuille : il a un vrai potentiel, mais il éprouve une authentique jouissance à torpiller ses chances. Parce qu’à ses yeux de petite frappe, la vie ne vaut le coup que dans le défi sans cesse relevé de la chute et de la renaissance… Et tant pis si ces calculs le ramènent sans cesse à son point de départ : Louie le tocard fauché.
Louie a pourtant un atout majeur dans sa manche : une lucidité à toute épreuve. Il ne se fait d’illusions sur rien ni personne – et surtout pas sur lui-même. Il sait que dans son petit monde de minable, on ne respecte que la force. Peu importe qu’on soit un fieffé connard tant qu’on a du pouvoir. Frank Scarpia a un beau costard et un larbin qui lui ouvre la portière de sa Buick ? Bravo. Joe Brusher est un tueur sans âme qui décimerait une famille entière pour quelques billets de cent dollars ? Rien à dire. Son oncle Giovanni a vécu toute sa vie sur la crédulité de ses semblables ? Il est arrivé jusqu’à l’âge de 70 ans, c’est un exploit digne d’être salué. Il n’y a pas d’amour possible dans ce monde-là, juste du respect. Du moins tant que les comptes sont à l’équilibre. Car l’humanité se partage en deux catégories : ceux à qui on doit quelque chose, que l’on craint, et ceux qui nous doivent quelque chose, que l’on méprise. C’est à ce prix, et à ce prix seulement, qu’on peut espérer s’en sortir tout en grappillant les quelques billets qui permettront de se soûler ou de se taper une gonzesse. Proies et prédateurs : tels sont les deux genres d’hommes que fréquente Louie.
Pourtant, au fil de l’histoire, il sent que quelque chose est en train de se fissurer. Ce vieux monde est emporté par la modernité. Le téléphone chez son oncle, bien sûr – lui qui a passé toute sa vie à rencontrer les gens pour les rançonner ou partager un verre. Mais aussi ces jeunes Noirs et leur ghettoblaster. Et les Twin Towers, au bout de Manhattan, dressées comme deux pierres tombales sur leur petit milieu d’usuriers, de trafics de drogue et de costumes tape-à-l’œil. Un monde étroit, géographiquement et, plus encore, intellectuellement. Et immobile, comme ces vieux truands qui passent leur journée assis au café ou dans leur appartement poussiéreux, attendant que l’argent leur tombe dans les fouilles pour se taper une pute. On est loin des flamboyances du Parrain ou de la verve des Sopranos : Tosches nous montre des petits bourgeois du crime accrochés à leurs rentes, et qui voient leurs heures de gloire s’éloigner lentement dans un crépuscule sans gloire ni illusions. Ces gens n’ont jamais voulu aller au-delà d’eux-mêmes, ni de leurs désirs primaires qu’ils assouvissaient d’un verre de whisky, d’une balle dans la tête ou d’un coup de queue. Arrivés au bout du chemin, ils restent là, figés dans leurs traditions et leur méfiance intrinsèque à l’égard de tout ce qui ressemble à un autre être humain – car faire confiance, c’est se condamner à la trahison. Proie ou prédateur, choisis ton camp.
Louie connaît lui aussi ce dilemme : peut-il prendre le risque d’aimer Donna Lou, dont il est fou amoureux ? Ou doit-il la traiter comme les autres, par la défiance et la moquerie ? Aimer, c’est un risque à prendre : un risque beaucoup trop élevé pour un homme de son acabit, un petit voyou qui ne doit jamais faire preuve de faiblesse – usurier jusque dans l’âme. Un minable ? Oui, Louie est minable. Sauf que lui, contrairement à ses collègues en truande, en a parfaitement conscience. Et qu’il lui appartient de changer s’il en a la volonté.
Le futur sera-t-il meilleur pour autant ? Comme une menace, les tours jumelles du World Trade Center étendent leur ombre lugubre sur l’horizon. Tosches, et ce n’est pas là son moindre trait de génie, pressent que l’avenir ne sera pas exempt de périls. Et que la nouvelle Amérique, celle des financiers arrogants et des traders sous coke, n’aura rien à envier en cupidité à sa devancière, tranquillement assise devant son scotch de contrebande et son croc de boucher. Il l’a si bien compris qu’à la fin du livre, on le voit expliquer à Donna Lou, enfin reconquise, les multiples placements boursiers qu’il vient d’effectuer. Pour la même débine finale ? Les récents errements de l’économie mondialisée laissent à penser que bon nombre d’investisseurs ont, eux aussi, fini par communier à la religion des ratés – les grandes théories économiques en prime.
Par-dessus ces petits désastres, on voit planer le visage désabusé de Nick Tosches, son regard revenu de tout et sa bouche tirée par l’amertume. A-t-il fréquenté de près ce monde interlope, celui des paris jetés au vent, du whisky de six heures du matin et de la fille traînée de bar en bar jusqu’au plumard ou n’importe quel support digne de présider à un coït expéditif ? On peut le penser tant son œil est précis et son langage imagé. « L’autre jour, grogne le tueur Joe Brusher, je regardais la télé. Y avait un type, une espèce de tapette, qui descend un autre type, avec de la musique en arrière-fond, et ensuite, on voit le type qui a buté l’autre sur une terrasse, à siroter du châteauneuf-de-mes-deux avec une gonzesse qui se lèche les babines en le dévorant des yeux comme si c’était le Christ en train de bander. Putain ! Moi, la dernière fois que j’ai tiré mon coup, ça m’a coûté cent dollars. » Louie est un philosophe à sa manière, brutale et sans fioritures, mais non sans justesse : « Prends l’exemple des Kennedy, ou des gens comme ça. Ils nous disent qu’on est tous égaux. Mais jamais tu verras un négro à Hyannis Port, à moins qu’il porte un plateau en argent avec des gants blancs. Les chiens le dépèceraient. En morceaux égaux, évidemment. Ce qu’ils veulent dire, en fait, c’est qu’on est tous égaux, mais après eux. C’est eux, les Kennedy et les Kennedy noirs, les Jesse Jackson, qui parlent sans cesse des Blancs et des Noirs. Ils veulent pas que les gens s’aperçoivent – peut-être qu’ils s’en aperçoivent pas eux non plus – qu’en fait il y a les Blancs, les Noirs et eux. C’est leur pognon que tout le monde caresse pendant dix minutes les jours de paie. » Et quand il se regarde en face, Louie n’a pas de mots assez durs pour signifier ce qu’il pense de lui-même – et cet examen de conscience est magnifique. « Son mauvais œil ne remarquait que les imperfections. Son mauvais œil ne cherchait que les motifs de grief. Il espionnait perfidement dans tous les coins. En lui interdisant toute confiance, son mauvais œil lui avait évité d’être victime de la trahison. Mais il l’avait éloigné également de cette providence intérieure, cette lumière humaine qu’on appelle la sagesse, sans laquelle la méfiance était tout aussi désastreuse que la confiance elle-même, et aussi aveugle que pouvait l’être la confiance. Son mauvais œil, ainsi qu’il commençait à le redouter, l’avait privé des quelques bienfaits qui accompagnent parfois le mal, et avait nourri en lui une chose plus redoutable que tout ce qui le menaçait à l’extérieur. »
Nick Tosches est un immense écrivain, l’un des plus doués du roman noir. Trop doué ? Peut-être. Sa production romanesque s’est limitée à quatre titres, à la qualité inégale. « La Main de Dante », par exemple, est très en-deçà de la « Religion des ratés ». Le narrateur, un écrivain revenu de tout, ressemble comme un frère à Nick Tosches, à croire que l’auteur a été rattrapé par ses doubles de papier. Pourtant, le génie est encore là, lorsqu’il évoque en quelques pages fulgurantes la vocation de l’écrivain et son combat, perdu d’avance, contre les forces maléfiques de l’édition – ce commerce du papier imprimé qui asservit la créativité.
En-dehors de ça, il a consacré pas mal de temps à écrire la biographie de personnalités qui, à l’instar de Louie, se sont appliquées à passer gentiment à côté d’une belle destinée. Le boxeur Sonny Liston, par exemple, qui avait préféré se coucher devant Cassius Clay moyennant une bonne somme d’argent plutôt que défendre son titre de champion du monde des poids lourds. Ou le lymphatique crooner Dean Martin, dont le portrait doux-amer doit autant à Louie l’usurier qu’à Nick Tosches himself – même don exceptionnel en partie gâché par une même indolence, qui est l’autre nom de la peur. Il n’en reste pas moins que « La religion des ratés » est une réussite absolue, l’un des plus grands romans noirs de ces cinquante dernières années. Œuvre habitée et à maints égards prophétique, œuvre d’un écrivain trop grand pour ses personnages peut-être, ou trop semblable à eux, allez savoir…
Gallimard, 1988.
P.S. : Nick Tosches est allé voir ce qui se passe dans l’au-delà le 20 octobre 2019. Il avait 69 ans. Le plus étonnant n’est pas qu’il soit mort si jeune, mais qu’il ait tenu jusque-là.
Découvrez mon prochain article « Gillian FLYNN – Les apparences »
Acheter le livre « Nick TOSCHES – La religion des ratés«
