Umberto ECO – Le nom de la rose
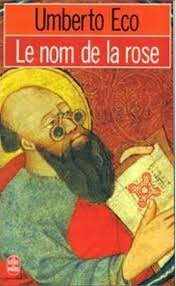 « Le nom de la rose ». Plus qu’un titre, une référence incontournable pour tout auteur qui se frotte au thriller historique. Lorsque ce livre paraît, il y a trente ans déjà, le genre était peu – voire pas du tout – représenté. Et voilà qu’un certain Umberto Eco, sémiologue connu des seuls cercles universitaires, s’amuse à bouleverser tous les codes littéraires en vigueur en situant une intrigue de polar dans une obscure abbaye italienne du XIVème siècle, et en utilisant de surcroît la forme du huis-clos, le dispositif narratif de plus exigeant qui soit. Plus qu’un tour de force, une gageure. Le résultat, on le sait a été à la hauteur de l’événement : « Le nom de la rose » est devenu un classique en moins de temps qu’il n’en faut pour dévorer cette chronique médiévale qui joue à être un thriller.
« Le nom de la rose ». Plus qu’un titre, une référence incontournable pour tout auteur qui se frotte au thriller historique. Lorsque ce livre paraît, il y a trente ans déjà, le genre était peu – voire pas du tout – représenté. Et voilà qu’un certain Umberto Eco, sémiologue connu des seuls cercles universitaires, s’amuse à bouleverser tous les codes littéraires en vigueur en situant une intrigue de polar dans une obscure abbaye italienne du XIVème siècle, et en utilisant de surcroît la forme du huis-clos, le dispositif narratif de plus exigeant qui soit. Plus qu’un tour de force, une gageure. Le résultat, on le sait a été à la hauteur de l’événement : « Le nom de la rose » est devenu un classique en moins de temps qu’il n’en faut pour dévorer cette chronique médiévale qui joue à être un thriller.
Et pourtant, quoi de plus étranger au lecteur contemporain que ces moines passant leur vie terrestre entre les quatre murs d’une abbaye perdue au fin fond de la Ligurie ? Les repères ont complètement changé. Nous sommes en 1327. L’empereur Louis de Bavière, protecteur du Saint-Empire romain, s’oppose au pape Jean XXII, replié en Avignon sous la protection du roi de France. D’innombrables luttes intestines déchirent l’Eglise : cardinaux romains corrompus, moines hérétiques, controverses idéologiques entre bénédictins et franciscains, enrichissement des communautés religieuses aux dépens du bon peuple… Comme si cela ne suffisait pas, les livres en langue vulgaire se multiplient, et avec eux des idées que l’Eglise réprouve avec la dernière énergie. On s’aperçoit soudain que si les factions en présence ne portent plus les mêmes noms, la violence, l’anathème et l’exclusion restent des modes de communication privilégiés. Le lecteur d’aujourd’hui se retrouve en terrain familier.
Guillaume de Baskerville, moine franciscain d’une cinquantaine d’années et ancien inquisiteur, rejoint donc une abbaye du nord de l’Italie – qui ne sera jamais nommée – en compagnie de son secrétaire, le novice bénédictin Adso de Melk. Celui-ci sera le témoin principal des événements qui vont se succéder en ces lieux inquiétants. Il apparaît que l’abbé Abbon, qui dirige cet imposant édifice, a fait mander Guillaume de Baskerville pour tenter de résoudre un mystère. Le corps sans vie d’un moine, le jeune Antelme d’Otrante, a été retrouvé au pied de l’une des gigantesques tours qui abritent l’orgueil de l’abbaye : la bibliothèque, célèbre dans toute la chrétienté pour la magnificence de ses ouvrages et la diversité de ses collections. Il apparaît très vite que ce décès ne peut être un suicide : la fenêtre d’où est tombé le malheureux était fermée lorsqu’on a découvert son cadavre. Accident ? Peu probable, puisque le drame est survenu en pleine nuit. Meurtre ? Ou faut-il plutôt y voir la main du Démon ? L’abbé Abbon semble pencher pour cette épouvantable hypothèse, au contraire d’un Baskerville qui en tient pour l’analyse scientifique des faits. Sa sagacité sera mise à rude épreuve, d’autant que des meurtres vont se succéder, tous plus effrayants les uns que les autres. Les soupçons de possession diabolique vont amener sur les lieux le redoutable inquisiteur Bernardo Gui, aussi respecté que cruel, au moment même où une rencontre de la plus haute importance théologique doit opposer bénédictins et franciscains sur la question cruciale du pouvoir temporel de l’Eglise. Baskerville va devoir faire preuve de facultés de déduction hors du commun pour louvoyer entre les écueils, tant religieux que criminels. Toutes les pistes convergent vers cette étrange bibliothèque dont l’accès est interdit à quiconque, sauf au bibliothécaire. La clé de l’énigme, sans aucun doute possible, est dissimulée dans les recoins obscurs de cette forteresse du savoir.
Avec « Le nom de la rose », Umberto Eco administre une leçon romanesque de toute beauté. Roman-monde, roman-univers même puisque les perspectives dépassent de très loin les vicissitudes humaines : pour tous les protagonistes, il n’est question que du salut de l’âme, captive d’un corps et d’un intellect qui ne cessent de faire écran entre l’homme et son créateur. C’est le grand mérite de ce livre de rendre palpables, quasi charnels, les tourments de ces êtres de chair et de sang tout entiers dédiés à Dieu. Fort d’une culture encyclopédique, Umberto Eco – dont les longues descriptions, parfois ardues, participent de cette atmosphère de satiété religieuse et d’étouffement cérébral – nous plonge dans un chaudron où bouillonnent mille menaces. Dieu est partout, donc le mal aussi, et la tentation omniprésente. Le lecteur voit se déployer sous ses yeux une société travaillée par le démon de la pureté, cette pureté tant recherchée mais sans cesse menacée, ainsi que le rappellent les bas-reliefs gravés au fronton de l’église abbatiale. Le malheur, c’est qu’il y a de la beauté dans cette vie terrestre, comme le prouvent les enluminures qui ornent les manuscrits les plus précieux, véritables joyaux de l’art médiéval. Au fil d’une érudition étourdissante, Umberto Eco excelle à rendre le climat de croyance et de terreur qui baignaient ces temps légendaires. Dialectique de la transcendance : plus l’âme tend vers Dieu, plus le corps implore grâce. Névroses et hystéries se consument dans la mortification. Mais que faire de l’intellect quand il renâcle ? Face aux dangers que représente une raison trop éclairée, il n’y a que deux issues, celle de la connaissance qui illumine et celle du crime qui éteint. C’est à ce face-à-face philosophique qu’est convié le lecteur du « Nom de la rose ».
Il est vrai que tous les éléments d’un bon polar sont réunis dans cette chrétienté minée par les dissensions politiques et les controverses théologiques. Les antagonismes menacent à chaque instant de dégénérer en règlements de compte. En ce temps-là, les vérités étaient intangibles et les fautifs sévèrement châtiés. Le moindre point de dogme – ne parlons même pas de la question de l’existence de Dieu, dont la seule mention confine au blasphème – peut déboucher sur l’exil ou la mort. Cette époque ne souffre pas la nuance et le saint d’un jour peut, s’il n’y prend garde, devenir l’hérétique du lendemain. L’ordre est nécessaire, qui autorise toutes les compromissions. Sous couvert de charité chrétienne, les autorités imposent la concorde civile, traînant après elle son cortège d’ecclésiastiques corrompus et de princes accoudés aux crosses des évêques. Tiède, le Moyen Age ? Au contraire, c’est le temps des convulsions, des excommunications et des carnages dûment absous.
Sans avoir l’air d’y toucher, Umberto Eco nous convie à la noce des rois et des mitrés. Toute l’ambiguïté de l’époque est rassemblée dans le huis-clos de l’abbaye : héritière d’un homme mort nu sur la croix, l’Eglise se calfeutre dans ses refuges monumentaux, bien à l’abri de ses sujets. Sans cette pompe, ces vêtements sacerdotaux brodés d’or et ces bibles aux reliures éblouissantes, elle risquerait de perdre sa légitimité et, avec elle, son pouvoir d’intimidation vis-à-vis d’une populace ignare et superstitieuse. Les menaces sont récurrentes : à peine avait-on massacré les Cathares qu’il fallait mettre au pas le puissant ordre des Templiers. Et voici qu’advient un nouveau péril : la montée en puissance de l’ordre des franciscains, qui prônent le renoncement aux biens matériels et le retour au peuple. Au risque de menacer les puissants cardinaux de Rome ? On comprend vite que les disputes théologiques auxquelles assiste le lecteur d’Umberto Eco ne sont que prétextes à régler une question bien plus fondamentale : qui, du pape ou de l’empereur, dirigera la chrétienté ? L’enjeu est moins philosophique que patrimonial. Celui qui guidera les âmes pourra s’enrichir en toute quiétude. Un modus vivendi est donc nécessaire.
On peut être une puissance spirituelle sans perdre de vue ses intérêts les plus triviaux : les biens de l’Eglise sont considérables et, pour les protéger, le pape a besoin de l’épée du roi, autant que le roi a besoin de l’onction papale pour imposer la crainte à ses manants. Cul et chemise, pouvoir temporels et spirituels se font la courte échelle pour asseoir leur domination sur des masses de moins en moins crédules. Pratique des indulgences d’un côté, arbitraire royal de l’autre : les deux institutions portaient en elles les ferments de la Réforme protestante et des nombreuses jacqueries qui allaient émailler la fin du Moyen Age. Pour n’avoir pas su trancher cette question une bonne fois pour toutes, l’Eglise catholique devait subir un discrédit qui irait en s’amplifiant au fil des siècles. Les récents scandales entourant la banque du Vatican ne constituent que les lointains échos de cette contradiction fondamentale.
Ironie de l’Histoire, et de cette histoire en particulier, c’est un objet de taille modeste qui va bouleverser ce bel ordonnancement – et l’on touche ici au coup de génie d’Umberto Eco, qui allait d’ailleurs nous éblouir plus d’une fois par la suite. Tout cet univers de piété tourne autour du livre. Dans le dispositif codifié de l’abbaye où la reproduction des textes est assurée par une armée de moines copistes, le livre est un objet de foi et de déférence, splendide dans ses enluminures mais enfermé à double tour entre les murs de la bibliothèque. Magnifiée, la Révélation se trouve dans le même élan soustraite aux regards. Il n’en reste pas moins que le livre est aussi objet de connaissance, et l’on s’aperçoit que ces pages rehaussées d’or fin recèlent un venin qui a fini par troubler la tranquillité du scriptorium. A terme, c’est l’Eglise tout entière qui en sortira ébranlée. Homme de connaissance autant que de foi, Baskerville – clin d’œil à Conan Doyle au passage – ne craint pas la vérité. Il recherche la compagnie des manuscrits car il fait le pari que science et convictions religieuses sont complémentaires. Ses adversaires, pour leur part, redoutent la menace que fait peser la connaissance sur la conscience. Peut-on préjuger de ce que verra l’homme lorsqu’il lèvera les yeux de son grimoire ? Ne s’expose-t-il pas au péché d’orgueil ? Plus grave encore, ne risque-t-il pas de remettre en cause l’ordre établi ? Acceptera-t-il encore les mensonges apaisants, ou optera-t-il pour la vérité dérangeante ? De tout temps, les institutions ont préféré l’injustice au désordre. Rarement cette thématique aura été aussi lumineusement exposée que dans ce roman aux allures de plaidoyer pour la raison.
Encore fallait-il en situer l’intrigue dans le contexte adéquat, et Umberto Eco trouve l’allégorie parfaite : à l’instar des moines, prisonniers consentants de leur abbaye mais en quête de réponses à leurs doutes lancinants, les livres sont enfermés dans une bibliothèque en forme de labyrinthe – salut à toi, Borges et ta célèbre bibliothèque de Babel. La connaissance est enclose dans les hauts murs de la forteresse, prise au piège de la règle monastique – sauf pour les quelques téméraires qui, à leurs risques et périls, ont osé enfreindre la consigne. L’édifice prend l’aspect d’un dédale meurtrier, dont l’ordonnancement ne peut être décrypté que par l’intelligence la plus pénétrante. Secondé par le jeune Adso, Guillaume de Baskerville se lance à la poursuite de ce qui va s’avérer bien plus qu’un livre : c’est l’avenir de l’Homme qu’il traque dans les entrailles du monstre. Fait contre foi, démonstration contre conviction, le franciscain plonge à son insu dans la modernité. Il coulera encore bien de l’eau sous les ponts, et bien du sang dans les geôles de l’Inquisition, mais le processus est en marche. La soif de vérité ne se tarira plus, la Renaissance pointe déjà le bout de son nez. Dans un peu plus d’un siècle, le livre cessera d’être cette œuvre d’art réservée à une élite savante et craintivement révérée pour se muer en objet usuel, écrit en langue vulgaire et plus seulement en latin, imprimé à des centaines d’exemplaires et vendu sur les marchés. La pensée ne sera plus l’apanage des hommes d’Eglise mais deviendra aussi l’affaire des savants. Les idées suivront le mouvement, que ni prince ni pape ne parviendront à endiguer. L’Homme va prendre place au centre de la création.
En toute clairvoyance, Umberto Eco jette ses héros en plein tumulte. Souverain pontife contre empereur, franciscains contre bénédictins, hommes de foi contre hommes de loi, peuple contre puissants, la chrétienté est à un carrefour. Qui dira ce que l’Europe doit aux événements qui se sont déroulés en cette froide semaine de novembre 1327, au cœur d’une abbaye oubliée ?
Et qui dira ce que le genre du thriller doit au « Nom de la rose » ?
Grasset, 1982.
Découvrez mon prochain article « René-Victor PILHES – L’imprécateur »
Acheter le livre « Umberto ECO – Le nom de la rose«
